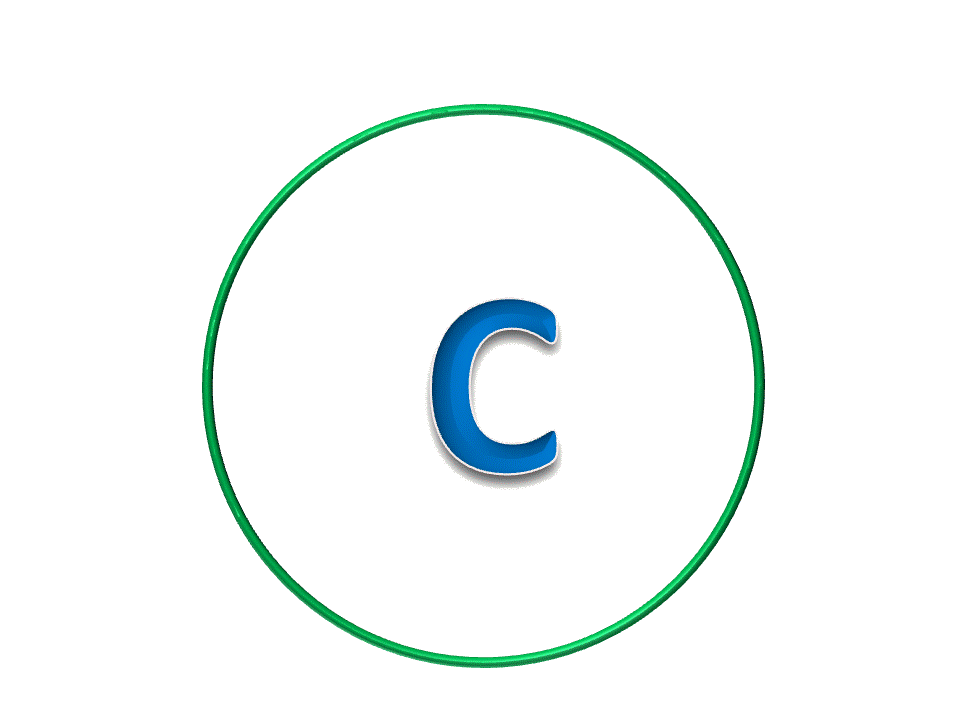
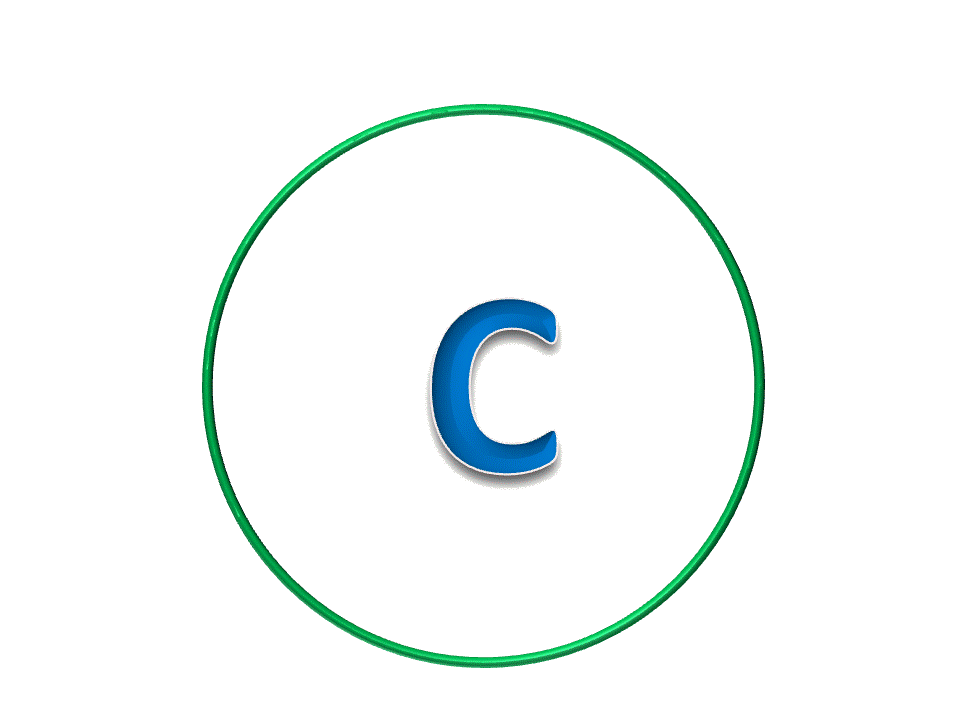
|
La Technique romaine des adductions d'eau, des Alpilles à la ville d'Arles |
|
I)
Introduction : De
nombreux textes ont déjà traité ce sujet de la plus brillante des façons. J'ai
la plus grande admiration pour des personnalités telles que le professeur
Philippe Leveau, Camille Liot et beaucoup d'autres, mais j'ai quand même
ressenti le besoin de rendre le sujet moins détaillé, plus accessible et de
présenter à ma manière un condensé que je n'ai pas
désiré développer en faisant appel à
de nombreuses références littéraires et historiques. II)
Les
têtes pensantes : A
l'époque romaine des hommes éminents ont été à l'origine de grandes théories
qui furent scrupuleusement appliquées. a)
Le premier fut VITRUVE, architecte romain
du 1er siècle avant J.C. Avant
d'entreprendre de gros travaux de captage de sources, ce dernier ne possédant
pas encore de procédés de laboratoire pour l'analyse des eaux, préconisait
d'étudier l'état de santé des habitants des lieux (membres robustes, teint
coloré, jambes seines, yeux purs), de constater que quelques gouttes d'eau ne
tachaient pas le cuivre de Corinthe et d'examiner si une fois bouillie, l'eau
ne présentait pas de dépôts sableux ou limoneux. Une
fois les sources choisies et acceptées, il fallait étudier le terrain. Le
premier travail était de celui du nivellement au moyen d'instruments tels que
le dioptra et le chorobate (voir paragraphe VI). b)
PLINE (23 à 79 de notre ère) préconisa
plusieurs méthodes pour l'étanchéité des aqueducs et indiqua également le
pourcentage des pentes à respecter. c)
FRONTIN (40 à 103 de notre ère) fut
consul et curateur des eaux entre autres. Il écrivit le traité des eaux de Rome
et ses commentaires servirent de guide pour la construction des aqueducs. III)
Le
captage des eaux : a)
Les sources : Pour
les romains, la qualité de l'eau ainsi que débit, étaient essentiels. C'est
pourquoi les eaux fraîches et claires étaient privilégiées par rapport aux eaux
courantes. Des petites sources étaient récupérées au passage de l'aqueduc afin
d'augmenter le débit. Ce fut le cas pour l'aqueduc du Sud des Alpilles qui
captait les sources du Mas d'Escanin, de la Fontaine d'Arcoule, du vallon d'Auge
et du Mas de la Dame. L'aqueduc du Nord des Alpilles captait la source du Mas
Créma, du Petit Saint-Didier, Vallonge,
de Valdition et de la Font de l'Amourié sur la colline du Contras, de Sounègues
et de Calafiguières. Certains
captages ne sont pas connus de manière certaine et font encore l'objet de
nombreuses réflexions de la part des experts. b)
Les barrages : Lorsque
l'eau coulait dans une gorge étroite, on barrait le vallon pour accumuler une
grande quantité d'eau. Le captage était ensuite réalisé environ à 6 mètres au
dessus du fond. On
peut citer le barrage de La Baume pour l'alimentation de Glanum près de
Saint-Rémy, le barrage en grand appareil sur le versant méridional des Baux
alimenté par quatorze petites sources et le barrage du vallon d'Auge. IV)
Le
tracé des Aqueducs : Comme
l'avait préconisé VETRUVE, il fallait étudier le terrain afin de réaliser les
travaux les plus adaptés et les plus faciles à mettre en oeuvre. Ainsi face à
une colline, les techniciens romains devaient faire le choix entre la contourner
en tranchée, ou la traverser en tunnel. Entre le Mas Créma et la ville d'Arles
les deux procédés ont été utilisés. Plusieurs
facteurs entraient alors en jeu : La ligne de pente à suivre, la longueur
du contournement, la profondeur de la tranchée, la qualité du matériau à
traverser. Le
plus souvent on faisait suivre à l'aqueduc une ligne de pente dans une tranchée.
Ce qui explique un tracé très peu rectiligne, serpentant entre les mamelons de
colline. Pour
le franchissement des vallons, l'ouvrage était rectiligne et aérien. La
dénivelée totale de l'aqueduc d'Arles a été évaluée à 38 mètres pour une
longueur de 48 kilomètres, ce qui lui donnait une pente confortable.
En 2010/2011 le professeur Philippe Leveau a effectué une campagne
de relevés altimétriques sur différents tronçons
de l'aqueduc entre les Alpilles et Arles, le but final étant
de pouvoir calculer le débit moyen du canal. La pente minimum
conseillée était de 20 cm par kilomètre. Celle
de l'aqueduc alimentant la ville de Nîmes est de 24,8 cm par
kilomètre. Dans le cas de pente trop forte du sol, la réalisation
d'une ou plusieurs chutes d'eau ralentissait le débit et
permettait le contrôle de la déclivité du canal
pour obtenir un débit moyen de 250 litres/seconde.. V)
La
construction des Aqueducs 1)
La construction en sous-sol
comprenant deux types d'ouvrages : a)
La trachée ouverte était la plus
pratiquée et sa profondeur variait de 3 à 4 mètres pour une largeur de 2,50
mètres environ. Au
fond de la trachée on construisait le radier d'épaisseur 30 cm environ,
constitué de gros béton de chaux avec sable graveleux et petits cailloux de 4 à
5 cm pour la couche basse, surmontée par un béton de chaux plus fin avec sable
graveleux et gravillon pour la couche de finition.
Sur
ce radier on montait sur une hauteur de 70 à 80 cm, deux pieds droits en
pierres maçonnées ou en béton de chaux, d'épaisseur 30 à 40 cm. Une
voûte en pierres maçonnées sur coffrage cintré, recouvrait le tout. Parfois cette
voûte était remplacée par des dalles en pierre taillée.
L'ouvrage était ensuite remblayé avec les produits
d'extraction jusqu'au niveau supérieur du terrain. Un
enduit d'étanchéité réalisé avant la couverture et constitué de chaux grasse,
de sable fin et de fragments de briques d'argile cassées, recouvrait le fond du
caniveau et les deux parois verticales sur une épaisseur d'environ 5 cm. Un
solin d'étanchéité de même constitution était réalisé sur les deux angles
droits du conduit. b)
Le percement en tunnel était moins
courant, mais se pratiquait si la profondeur sous radier était supérieure à 4
mètres.
Après
avoir déterminé le tracé sur la partie haute de la colline à franchir, les
techniciens romains faisaient percer plusieurs puits jusqu'au niveau bas du
canal qu'ils reliaient ensuite par des galeries souterraines. Ils terminaient
enfin la section à creuser afin d'y bâtir l'aqueduc. Les puits servaient à la
fois à l'évacuation des déblais et à
l'acheminent de tous les matériaux de construction. Sur
le versant nord des Alpilles et dans la traversée de la Crau, les tunnels que
l'on connaît sont de longueurs relativement courtes. Mais
les Romains purent creuser des tunnels de plusieurs centaines de mètres, comme
celui situé sous le col d'El Babel en Algérie qui mesurait 428 mètres. 2)
Les constructions en ouvrages
aériens : Dans
un vallon, le canal ou « specus » était posé sur un mur de
soutènement en pierres maçonnées ou « substructiones ». quand le mur
dépassait 2 mètres de hauteur, on allégeait la construction avec des arches
d'ouverture 5 à 6 mètres. C'était « l'opus arcuatum ». Les
piliers supportant les arches s'appuyaient le plus souvent sur des fondations
faites en « gros appareil », c'est-à-dire en gros blocs calcaires
posés à plat destinés à répartir la charge au sol. A leur origine les
pont-aqueducs avec « opus arcuatum » étaient réalisés en gros
appareil comme en témoigne celui de
Sumian à Fontvieille construit au 1er siècle après J.C. Entre le 1er
et le 4ème siècle après J.C., des réfections en « petit
appareil » furent entreprises comme ce fut également le cas au Vallon des Arcs près de Fontvieille.
Pour
franchir un ravin ou une grande rivière, une ouverture d'arche pouvait
atteindre jusqu'à 38 mètres, comme celle du pont d'El Kantara. Le Pont du Gard
est fait de trois niveaux d'arcades et atteint 49 mètres de hauteur. C'est le
plus grand des aqueducs romains.
VI)
Les
instruments de mesure des géomètres du temps romain :
Un
très intéressant article du "C.I.D.S." »
décrit parfaitement les divers instruments de mesure utilisés par les géomètres
romains ou « agrimensores ». Suivre le lien : http://www.pontdugard.free.fr/dynindex.htm?instrument
(Clichés et texte : Jacques Lucas) |
|
|
|